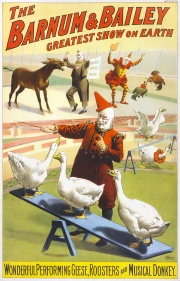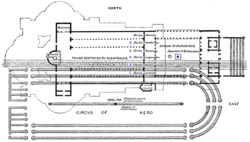D'où
vient le cirque
( simple)
le
cirque au temps des romains
Les romains avaient de nombreux jours
fériés, qu'ils utilisaient souvent pour voir des
spectacles: théâtre,mime,danse...
Ce qu'ils
préféraient était le jeu du cirque, il y
avait des courses de chars et des combats de gladiateurs.
Aujourd'hui le cirque est un
spectacle
mettant en scène des artistes
mais souvent également des animaux.
Les cirques ont généralement lieu sous un chapiteau.
Les activités du cirque sont : le
trapèze, le jonglage, le dressage de fauve...
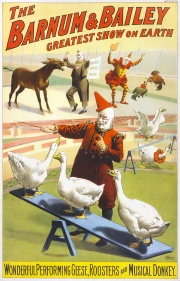
Une affiche d'un cirque (1900)
Les formations aux métiers du
cirque
Seuls deux écoles préparent au
diplôme des métiers des arts du cirque (DMA) d'un
niveau bac+2: l'école national supérieur des arts du
cirque (ENSAC) à Chalons en Champagne,et l'école
national du cirque Annie Fratellini.
Artistes du cirque
( Plus
compliqué
 Pour les articles homonymes, voir Cirque
(homonymie).
Pour les articles homonymes, voir Cirque
(homonymie).
Un cirque, dans le
monde romain,
est un édifice public où étaient organisées
des courses
de chars et de
chevaux attelés ou montés, voire des courses
à pied, des combats de lutte ou de boxe, bien que ces
spectacles d'athlétisme
soient ordinairement réservés aux stades.
Sous l'Empire,
il y a un véritable engouement pour les chevaux et les
courses, 64 jours par an étant consacrés aux jeux du
cirque, contre 17 sous la République,
chaque journée comprenant 24 épreuves, voire plus1.

Cirque
Flaminius (Rome),
par Bartoli, 1699 :
vision raccourcie, mais explicite
Architecture

Plan du Circus
Maximus (Rome)
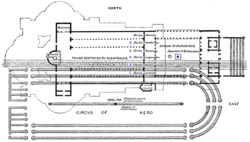
Plan du Circus
Vaticanus (Vatican)

L'oppidum
du Cirque
de Maxence
Plan d'un cirque romain
l’oppidum (bâtiment
comprenant les écuries et les stalles de départ) n'est
pas perpendiculaire à la piste, mais disposé en
oblique, de manière à compenser les handicaps
résultant des positions de départ plus ou moins
avantageuses.
La piste et les gradins
Le cirque romain était constitué d'une
piste oblongue (de forme allongée) sablée tournant
autour d'un mur bas central, et de gradins (cavea) construits
en maçonnerie, souvent sur arcades, ou plus simplement, en
bois ou même adossés sur un talus. Les places d'honneurs
étaient en marbre.
Le
mur : la spina
Le mur central (spina, pluriel spinae),
très peu élevé, mais large de plusieurs mètres,
était orné de marbres,
de statues et d'obélisques
ou de fontaines plus ou moins prestigieux. Les plus beaux obélisques
égyptiens
de Rome proviennent
des spinae des différents cirques.
Les
bornes : meta
Les extrémités du mur étaient
protégées par des bornes très solides (meta,
pluriel metae), autour desquelles tournaient les équipages
de chars,
avec auriges
(conducteurs de chars) et chevaux.
L'une des extrémités de la piste et des
gradins était en demi-cercle (sphendonè),
l'autre accueillait les stalles de départ (carceres),
inscrites dans un bâtiment d'écuries appelé
oppidum
(« la place forte »).
La tribune d'honneur
Une loge monumentale, aménagée
au-dessus d'une tribune, accueillait l'empereur ou les responsables
locaux, ainsi que les généreux commanditaires du
spectacle. Elle surplombait cette tribune offrant une meilleure vue
d'ensemble à ses occupants.
La tribune d'honneur communiquant directement au
palais impérial était nommée pulvinar à
Rome (dans le Circus
Maximus) et Kathisma à Constantinople (dans
l'hippodrome).
Quelques cirques romains
Article détaillé :
Liste
des cirques romains.

Place du Circus
Maximus, avec le Palatin
à droite de la photo
Cirques, stades, amphithéâtres et hippodromes

Trèves
possédait un cirque
(pour les courses
de chars), et un amphithéâtre
(pour les jeux
du cirque et combats de gladiateurs)
Il ne faut pas confondre les cirques,
hippodromes
destinés aux courses
de chars et de
chevaux, avec les stades
de Rome (piazza
Navona : stade
de Domitien), et des pays de tradition hellénique (Grèce
continentale, îles
Égéennes, Asie Mineure), de forme à première
vue similaire, mais destinés aux exercices d'athlétisme,
et donc de dimensions plus modestes et dépourvus de mur
central et de stalles.
Il ne faut pas non plus confondre les cirques
avec les amphithéâtres
(de forme elliptique, type Colisée
ou arènes
d'Arles, amphithéâtre
de Capoue), destinés aux combats de gladiateurs,
aux venationes
(spectacles de combats avec des fauves) et naumachies,
souvent nommés, un peu à tort, Ludi
circenses.
Mais il est vrai qu'en
latin, on a toujours appelé circenses les jeux de
l'amphithéâtre :
l'expression latine Panem
et circenses (« du pain et des jeux »)
comprenait tous les jeux, ceux de l'amphithéâtre
comme ceux du cirque. L'image du sport hippique utilisé comme
un puissant moyen de dépolitisation des masses et d'aliénation
de la population doit être nuancée car ces jeux qui
attirent beaucoup de monde peuvent être source de trouble
public et de manifestation politique envers l'organisateur des jeux2.

Obélisque de l'hippodrome
de Constantinople
Les obélisques
Des obélisques,
égyptiens ou non, décoraient la spina des
cirques romains : obélisque
du Latran provenant du Circus
Maximus, obélisque
du Vatican du cirque
de Caligula et de Néron, ou obélisque
de Théodose encore en place au centre de l'Hippodrome
de Constantinople.
Le cirque de nos temps
 Pour les articles homonymes, voir Cirque
(homonymie).
Pour les articles homonymes, voir Cirque
(homonymie).
 Pour les articles ayant des titres homophones, voir CIRC
et Sierck.
Pour les articles ayant des titres homophones, voir CIRC
et Sierck.


Cet article adopte un point de vue régional
ou culturel particulier et nécessite une internationalisation
(décembre 2016).
Merci de l'améliorer
ou d'en discuter sur sa page
de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à
internationaliser en utilisant {{section
à internationaliser}}.

Chapiteau
du cirque Barum en Allemagne.
Un cirque est une troupe d'artistes,
traditionnellement itinérante, qui comporte le plus souvent
des acrobates,
propose des numéros de dressage
et de domptage
d’animaux et donne des spectacles de clowns
et des tours
de magie. Plus généralement au XXIe siècle,
le cirque est un spectacle
vivant populaire organisé autour d’une scène
circulaire. Le terme cirque vient du latin circus, en référence
à une enceinte circulaire.
Ses caractéristiques ont eu beaucoup
d’évolutions dans le temps. Aujourd'hui, le cirque
existe sans sa scène circulaire, en salle ou dans des lieux
particuliers, aux côtés de pièces de théâtre,
de danse, etc. La dénomination cirque s'est « réduite »
à la seule pratique d'une discipline de cirque (acrobatique,
aérienne, équilibres, manipulation/jonglage, etc.).
Avec l'apparition des écoles de cirque en France et à
l'étranger à la fin du XXe siècle,
et une opposition
croissante à l'utilisation d'animaux sauvages dans ces
spectacles, les artistes de cirque se sont émancipés
de la famille traditionnelle et très peu d'entre eux sont des
enfants de la balle. La dénomination est d'ailleurs un sujet
de discorde depuis les années
1970 entre les puristes du cirque traditionnel et les
avant-gardistes qui utilisent le même mot pour exercer un art,
finalement, très différent.
En pratique, 90 villes
françaises ont éliminé les cirques utilisant des
animaux captifs à des fins commerciales1
Historique
La conception occidentale du cirque s’inspire
d’une façon ou d'une autre des jeux
antiques romains ainsi que des bateleurs et troubadours
du Moyen Âge.
Le terme cirque vient du mot latin circus, « cercle »
relative à l'enceinte circulaire où se pratiquait les
activités du cirque antique.
La première représentation d’un cirque moderne
à Londres
date du 7 avril
17682
et est l'œuvre de Philip
Astley. Vétéran de retour d’Amérique,
il décide de représenter des spectacles équestres
avec des démonstrations d'acrobatie dans la Philip Astley's
riding school, école équestre dans laquelle est
construite la première piste circulaire pour pouvoir tenir les
chevaux depuis le centre, au bout de la chambrière (fouets à
long manche utilisé par les dresseurs de chevaux) dont la
longueur a déterminé la dimension internationale du
diamètre de la piste, 13,50 m3.
Le mariage du monde équestre militaire et du monde forain
autour du cercle est établi lorsqu'Astley égaye son
spectacle par des bateleurs, pantomimes et autres voltigeurs,
ajoutant des sièges et un toit conique à son anneau en
17734.
Cette nouvelle forme de spectacle, fondée essentiellement sur
des exercices équestres, est ensuite introduite en France en
1774 par Astley qui y ouvre le premier établissement
circassien stable et fixe, l'Amphithéâtre
Anglais, établissement repris en 1807
par Antonio
Franconi et ses descendants5.
C'est seulement au XIXe siècle lors des vagues de
colonisation que sont introduits en France et en Allemagne les
premiers animaux sauvages, le domptage étant créé
selon la tradition en 1819
par l'écuyer Henri
Martin qui soumet un tigre de la ménagerie Van Aken en
Bavière
et imagine une méthode alliant la violence et la douceur6.
Déjà à l'époque Monsieur
Loyal, maître du manège et présentateur du
spectacle de cirque, véritable fil rouge et repère
entre les numéros, était déjà présent7.
Cirque à l'ancienne

Cirque Franconi : exercices d'écuyère,
époque du Consulat.
Le
régime libéral de la Troisième
République en France favorisa la démocratisation
des loisirs. Si le théâtre restait le type de spectacle
le plus légitime, le cirque fit alors l'objet d’un fort
engouement car il touchait deux types de publics : les
aristocrates qui se reconnaissaient dans les écuyers incarnant
l'aristocratie du cirque et l'art équestre, élément
central dans l’identité collective de la noblesse depuis
le Moyen Âge,
et le peuple attiré par le spectacle des troupes ambulantes
qui sillonnaient la France8.
Sous l’impulsion de Théodore Rancy, les cirques « en
dur » se multiplièrent alors dans les grandes
villes françaises9.
La famille Franconi fonda successivement, à
Paris, trois théâtres de cirque portant le nom de
« Cirque
Olympique » :
Dans leur premier, les Franconi présentaient,
à l'époque napoléonienne, des animaux sauvages
dans leur spectacle de cirque à l'ancienne constitué de
numéros équestres et acrobatiques. Le cirque existe
depuis toujours, mais des gladiateurs de jadis il ne reste plus que
le souvenir, car acrobates, jongleurs, mimes et clowns les ont
remplacés. Dans le troisième, la création en
1831 de la pantomime
à grand spectacle « Les Lions de Mysore »
marqua l'avènement du domptage
au cirque. Le dompteur Henri Martin fut engagé, avec ses
fauves, par les frères Franconi qui montèrent pour lui
cette pantomime dans laquelle les félins du dompteur
marseillais étaient présentés derrière un
treillage placé sur le devant de la scène.
En 1856, Théodore
Rancy fonda son premier cirque (chapiteau ambulant) à
Rouen, puis
construisit les suivants en dur : à Genève
(1875), Lyon (1882),
Le Havre (1887),
Boulogne-sur-Mer
(1888), Amiens
(1889), Rouen
(1893), etc.

Cirque
d'été aux Champs-Élysées, gravure du
XIXe siècle.
À la fin du XIXe siècle, Paris
connut plusieurs cirques sédentaires en activité :
le cirque des
Champs-Élysées (1841-1898), connu sous les noms de
cirque de l'Impératrice ou de Cirque
d'Été ;
le cirque Napoléon
(1852), l'actuel Cirque
d'Hiver acquis par les Bouglione
seniors en 1934 ;
le cirque Fernando
(1875-1972) qui devient le cirque
Medrano en 1897,
« le Théâtre des clowns » ;
le Nouveau
Cirque (1886-1926), cirque-piscine construit rue
Saint-Honoré (doté d'une piste transformable en
piscine pour les pantomimes nautiques) ;
le cirque Molier, fondé en 1880 par Ernest
Molier (1850-1933)10,
près du bois de Boulogne, rue
Benouville à Passy.
Lors des deux représentations annuelles, artistes et
aristocrates se mélangent sur la piste, pour des numéros
où les chevaux ont la part belle11 ;
l'Hippodrome
au pont de l'Alma, inauguré en 1877, mêlant lions,
éléphants et courses de chars, qui ferme en 1892, et
auquel succède en 1894
l'Hippodrome du Champ-de-Mars, puis, en 1900,
l'Hippodrome
de Montmartre.
Le dernier cirque stable à ouvrir ses portes
dans la capitale française fut le cirque Métropole
(1906-1930) connu sous l'enseigne de cirque de Paris, lequel mit
souvent des dompteurs en vedette.
Cirque
traditionnel

L'éléphant Jack à l'Hippodrome
de Paris (1885).
Le cirque-ménagerie succéda au cirque
équestre du XIXe siècle.
Fondé en 1854 par une famille anglaise, les
Pinder, le Cirque
Britania traverse la Manche dès 1868 et prend le nom de
cirque-hippodrome des frères Pinder. Les convois étaient
tirés par des chevaux.
La fusion cirque-ménagerie fut popularisée
par le cirque anglais de Lord George Sanger entre 1856 et
1870, à l'époque où sa collection d'animaux
exotiques a été la plus importante parmi les ménageries
ambulantes de Grande-Bretagne.
À la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle, Barnum et ses successeurs,
aux États-Unis,
donnèrent un nouvel essor au cirque.

Scènes de cirque autour de 1891.
En 1871, Phineas
Taylor Barnum, avec ses associés William Cameron Coup et
Dan Castello, exploita le premier Cirque Barnum englobé dans
un ensemble voyageant par le train et réunissant musée
de curiosités, ménagerie, convoi et chapiteau.
Allié avec
James
Anthony Bailey, en 1881, il créa le premier chapiteau à
3 pistes qui prit le nom de « Barnum & Bailey
Circus » en 1887. Le cirque géant effectuera
une grande tournée dans toute l'Europe de 1897 à 1902.
Les frères Ringling, en 1907, rachetèrent
le cirque Barnum & Bailey pour l'associer au leur, le
Ringling Bros. Circus, fondé en 1884, et former, en
1919, le plus grand chapiteau du monde : le Ringling
bros. and Barnum & Bailey circus, The Greatest Show on
Earth.
Le Cirque Carl
Hagenbeck, fondé à Hambourg en 1887 sous le nom de
« Cirque international et Caravane cingalaise »,
a voyagé dans le monde entier, avec une ménagerie
importante, en complétant ses représentations par des
exhibitions zoologiques et ethnologiques, et a existé jusqu'en
1953.
Le Wild West Show de Buffalo
Bill, créé en 1884, effectua une tournée en
Europe en 1889 et en 1905. Le spectacle de l'Ouest
américain marqua longtemps les esprits notamment en France
où Sampion Bouglione
père récupéra un stock d'affiches du
véritable héros du Far
West, acquit en 1926 un grand chapiteau d'occasion et lui donna
le nom de « Stade du Capitaine Buffalo Bill ».
Le Cirque Sarrasani, créé en 1902 à
Dresde en Saxe,
impressionna l'Allemagne
et l'Amérique
du Sud par le prestige de son directeur le « Maharadjah »
Hans von Stosch-Sarrasani, Chevalier de l'Ordre Impérial
Persan du Lion et du Soleil, par l'organisation de ses installations
(caravanes, écuries, ménageries, tentes et chapiteaux)
et par le faste de ses spectacles qui se déroulaient, à
partir de 1918, sous l'un des plus beaux chapiteaux de structure
ronde et sur une piste de 17,5 mètres de diamètre.
En 1919, les frères (Friedrich, Rudolf, Karl
et Eugen) Knie transformèrent l'arène familiale à
ciel ouvert en un cirque sous chapiteau sous l’enseigne
« Cirque Variété National Suisse Frères
Knie ».
Le cirque s’est transformé en spectacle
exotique grâce à la présence d’animaux
sauvages et en fait sa notoriété (ou sa publicité)
par leur exposition lors d'une parade ou dans une ménagerie :
Entre les deux guerres mondiales, les cirques
français annexèrent à leur établissement
une ménagerie,
jusque-là spectacle forain. L'inverse se produisit également,
les ménageries foraines ajoutant un spectacle de cirque à
leur établissement. C'est aussi à cette époque
que les cirques français motorisèrent leurs convois
routiers. Ainsi s'imposèrent en France : le Zoo-Circus
des frères Court (1921-1932), premier grand cirque voyageur
français, le Cirque des 4 frères Amar (1924), celui des
4 frères Bouglione (1933), Pinder (1928-1972, direction
Charles Spiessert).
Le cirque-ménagerie se caractérise par
la présence de dompteurs ou de dresseurs d'animaux au sein des
fratries ou des familles de circassiens.
Alfred (frère
de Jules) Court forma en 1923 au Zoo-Circus son premier groupe mixte
de fauves intitulé « La Paix dans la Jungle ».
Les frères
Amar furent tous dompteurs : Ahmed, l'aîné des
Amar, présenta des tigres et des éléphants, Ali
des ours blancs, Chérif des lions et Mustapha, après
un accident avec un tigre, assura la direction du cirque.
Les Bouglione seniors
se spécialisèrent : Sampion comme dresseur de
chevaux, Joseph comme dresseur d'éléphants, Firmin
comme dompteur de fauves et Alexandre comme administrateur du
cirque.
Roger Spessardy (frère de Charles
Spiessert) fut dompteur de fauves chez Pinder et dirigea la
ménagerie.
À la veille de la
Seconde
Guerre mondiale, il circulait cinquante-quatre cirques, toutes
catégories confondues, par les routes de France12.
Après la Seconde Guerre mondiale, les cirques
français s'associèrent à la radio et à la
télévision, tels le Radio Circus puis Grand
Cirque de France (période 1949-1965) des Grüss-Jeannet
et Pinder ORTF
(1961-1969) avec le label de La
Piste aux étoiles. Pour corser leurs programmes, ils
mêlèrent le spectacle de cirque avec des éléments
étrangers à la piste : des présentateurs
vedettes, des prestations d'artistes de music-hall,
des exhibitions de champions sportifs et des jeux radiophoniques.
Autour des années 1970, les cirques français
les plus importants furent Amar (1973-1982, direction Firmin
Bouglione junior), Bouglione (les Bouglione juniors : Sampion,
Emilien et Joseph), Pinder (1972-1983, direction Jean Richard), Rancy
(1962-1978, création Sabine Rancy), Jean Richard (1968-1983),
Zavatta (1978-1991, création Achille Zavatta) ainsi que le
cirque à l'ancienne de la famille Grüss (1974, direction
Alexis Grüss junior).
Le cirque italien American
circus entama, avec son chapiteau à trois pistes, une
tournée en France, à la fin de l'année 1979, qui
fut suivie d'autres jusqu'en 1986. En 1981, le Cirque Bouglione prend
le nom d'American Parade, puis d'American Circus pour
contrecarrer son concurrent.
Des faillites retentissantes (Amar13
en 1973, Jean Richard en 1978 et en 1983, Rancy en 1978 et en 1987,
Achille Zavatta en 1991) et l'affaire American
circus14
en 1979 marqueront la « fin » du cirque
traditionnel en France et permettront son renouveau 15
.
Quelques
cirques sédentaires (cirques fixes ou cirques
d'hiver) subsistèrent16,
mais les établissements voyageurs furent très
nombreux17 :
en Europe
en Allemagne :
Busch-Roland, Hagenbeck, Althoff, Krone, Sarrasani, Barum ;
Roncalli ;
en Espagne :
Feijóo-Castilla ;
en Grande-Bretagne :
Bertram Mills, Chipperfield, Billy Smart ;
en Italie :
Togni, Orfei, Casartelli, Bellucci ;
en Suisse :
Knie, Nock, Conelli ;
en Belgique :
De Jonghe (qui tourna aussi au Congo belge) ;
en Amérique du
Nord
aux États-Unis : Ringling Bros
and Barnum & Bailey qui abandonna les spectacles sous
chapiteau en 1956, Clyde Beatty - Cole Bros, Carson &
Barnes, Vargas.
Nouveau cirque et cirque contemporain
Article détaillé :
Cirque
contemporain.

Scène de Dralion
présenté à Vienne par le Cirque
du Soleil.
Dans les années 1970, le cirque d'alors
s’essouffle, en mal de renouveau et aux prises avec une
certaine opposition
à l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques,
pendant que le mouvement du nouveau cirque fait son apparition
en France. Il est porté par la démocratisation du
cirque avec l’ouverture d’écoles de cirque agréées
par la Fédération
française des écoles de cirque. Le cirque s’ouvre
et se remet en question. Ce genre de spectacle qui s'est davantage
théâtralisé (comme Archaos,
Cirque
Baroque, Cirque
Plume, Zingaro,
la Compagnie
Mauvais Esprits, le cirque de Phare
Ponleu Selpak, La
Famille Morallès, Cirque ici - Johann Le guillerm, etc.) a
remis en question les conventions du cirque, dit désormais
cirque traditionnel, qui demeure cependant bien vivant,
assimilant certaines des innovations du nouveau cirque. Les
spectacles d'Arlette
Gruss, par exemple, adoptent des costumes et des musiques proches
de celles des québécois du Cirque
du Soleil tout en continuant à présenter des
numéros des disciplines traditionnelles, en particulier des
exercices de dressage. De plus avec la création des écoles,
des rencontres régionales et nationales sont instaurées,
ce qui donne au cirque des touches sportives et artistiques.
La nouvelle génération d'artistes des
années
1990 revendique désormais davantage que le nouveau cirque,
et s'appelle plus volontiers cirque
contemporain ou "cirque de création" (dans les
années
2000). Les frontières deviennent de plus en plus floues,
et les spectacles s'inspirent de plus en plus du mouvement de la
performance
ou encore de danse
contemporaine tout en s'éloignant du côté
spectaculaire ou sensationnel caractéristique du cirque
traditionnel ou même du nouveau cirque.
La
fin de Barnum
En janvier 2017, le cirque
Barnum annonce qu'il va fermer ses portes au mois de mai de la
même année, après 146 ans d'activité.
Cette décision, due à la baisse des recettes, elle-même
liée au fait que ce cirque ne montre plus de spectacle
utilisant des animaux
sauvages, est saluée
par les défenseurs des animaux18.
Liste de diverses spécialités présentées

Trapéziste.
Monsieur
Loyal
Acrobatie
Trampoline
Aérien
Clown
(Auguste, clown
blanc, bouffons,
burlesques...)
Contorsion
Dressage et domptage
d'animaux (aras
et perruches, autruches,
chameaux et
dromadaires,
chats, chiens,
colombes,
éléphants,
grands félins,
girafes, lamas,
otaries, ours,
serpents,
singes...)
Équestre
Équilibrisme
Fakir
Illusionnisme
Jonglerie
ce
texte vient de Wikipedia